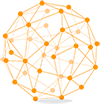Dans l’univers complexe des relations familiales, l’enfant occupe souvent une position paradoxale : à la fois sujet de sa propre existence et objet des projections parentales. Lorsque le couple parental traverse des difficultés relationnelles non résolues, un phénomène fascinant mais préoccupant peut émerger : l’enfant devient porteur d’un symptôme qui, tel un messager systémique, révèle les dysfonctionnements du système familial tout entier.
“Le symptôme de l’enfant n’est jamais isolé, il s’inscrit dans une chorégraphie relationnelle où chaque membre de la famille joue sa partition”, dans la lecture systémique développée à l’École de Palo Alto. Cette perspective nous invite à dépasser la vision linéaire de causalité pour adopter une lecture circulaire des interactions, où le symptôme n’est plus seulement un problème à éradiquer, mais un message à décoder.
Le couple parental : un système en quête d’homéostasie
La dynamique du couple à l’épreuve de la parentalité
La transition vers la parentalité constitue l’une des crises développementales les plus significatives dans la vie d’un couple. Cette métamorphose identitaire bouleverse l’équilibre préexistant et exige une réorganisation profonde du système conjugal. Cette transition peut raviver des blessures anciennes, des schémas relationnels dysfonctionnels ou des conflits non résolus. Comme le souligne Robert Neuburger, le couple parental se construit sur les ruines ou les fondations du couple amoureux, selon la solidité de ce dernier. Cette formulation impertinente mais juste illustre comment la parentalité peut soit consolider, soit fragiliser la relation conjugale.

Les conflits non résolus : un terreau fertile pour la triangulation
Lorsque les tensions conjugales persistent sans trouver de résolution, le système cherche naturellement à retrouver son équilibre. C’est dans ce contexte que l’enfant peut être inconsciemment recruté pour jouer un rôle stabilisateur. Une méta-analyse de 54 études impliquant plus de 500 000 participants (Auersperg, 2019) révèle que les conflits parentaux non résolus sont significativement associés à une augmentation des risques de troubles mentaux chez l’enfant, avec des odds ratios allant de 1,12 pour l’anxiété à 1,64 pour la consommation de tabac.
La triangulation, concept fondamental en thérapie familiale systémique, désigne ce processus par lequel l’enfant est impliqué dans la relation conjugale conflictuelle, devenant ainsi le troisième sommet d’un triangle relationnel pathogène. Cette configuration peut prendre diverses formes :
- La coalition, où l’enfant s’allie à un parent contre l’autre
- Le bouc émissaire, où l’enfant concentre sur lui les tensions du couple
- Le sauveur, où l’enfant tente de préserver l’unité familiale en sacrifiant son propre développement
L’enfant-symptôme : mécanismes de formation et manifestations
Du conflit conjugal au symptôme de l’enfant : une traduction systémique
Comment le malaise conjugal se transforme-t-il en symptôme chez l’enfant ? Ce processus s’opère à travers plusieurs mécanismes identifiés par l’approche systémique stratégique.
Le mécanisme de la double contrainte
La double contrainte, concept développé par Gregory Bateson et l’équipe de Palo Alto, constitue un piège communicationnel particulièrement toxique pour le développement psychique de l’enfant. Lorsque les parents émettent des messages contradictoires, plaçant l’enfant dans une situation insoluble, celui-ci peut développer des symptômes comme tentative d’adaptation à cette impasse relationnelle.
Par exemple, une mère peut demander verbalement à son enfant d’être autonome tout en communiquant non-verbalement son anxiété face à cette autonomie. L’enfant, pris dans ce paradoxe de la spontanéité, peut développer des comportements d’inhibition ou d’opposition qui représentent sa tentative de résoudre cette contradiction insoluble.
La parentification : l’inversion des rôles
La parentification constitue un autre mécanisme fréquent dans les familles où le couple parental est défaillant. L’enfant est alors investi d’un rôle qui ne correspond pas à son stade de développement, devenant le soutien émotionnel d’un parent ou le médiateur du couple. Cette inversion hiérarchique, bien qu’elle puisse temporairement stabiliser le système familial, engendre souvent des troubles anxieux, dépressifs ou identitaires chez l’enfant parentifié.
Comme le souligne l’article “L’autorité des parents sens dessus dessous”, cette confusion des rôles compromet gravement le développement psychoaffectif de l’enfant en le privant de la sécurité que procure un cadre parental structurant.
Les manifestations symptomatiques : du corps à la psyché
Les symptômes développés par l’enfant en réponse aux dysfonctionnements du couple parental peuvent prendre des formes variées, allant des troubles somatiques aux difficultés comportementales ou relationnelles.
Les troubles somatiques : le corps comme porte-parole
Les symptômes somatiques (énurésie, troubles du sommeil, maux de ventre récurrents, etc.) représentent souvent une forme d’expression privilégiée chez les jeunes enfants qui ne disposent pas encore des ressources verbales pour exprimer leur détresse. Le corps devient alors le porte-parole d’une souffrance psychique innommable.
Les troubles du comportement : l’agir comme communication
À mesure que l’enfant grandit, les symptômes peuvent évoluer vers des troubles du comportement plus manifestes : agitation, agressivité, repli sur soi, difficultés scolaires ou troubles oppositionnels. Ces comportements, souvent interprétés comme des problèmes inhérents à l’enfant, constituent en réalité des tentatives d’adaptation à un environnement familial dysfonctionnel. L’approche systémique de l’éducation nous invite à considérer ces comportements problématiques non comme des défaillances individuelles, mais comme des réponses adaptatives à un contexte relationnel perturbé.
Diagnostic systémique : repérer l’enfant-symptôme
Les signaux d’alerte : au-delà du symptôme apparent
Identifier la nature systémique d’un symptôme chez l’enfant nécessite une lecture attentive des interactions familiales. Plusieurs signaux peuvent alerter le clinicien sur la possible fonction symptomatique de l’enfant dans l’équilibre du couple parental :
- La résistance paradoxale au changement : malgré les plaintes des parents concernant le symptôme de l’enfant, toute amélioration suscite de nouvelles préoccupations
- La rigidification des rôles familiaux autour du symptôme
- L’intensification des conflits conjugaux lors des périodes d’amélioration symptomatique
- La présence de prophéties auto-réalisatrices concernant l’enfant
Interventions thérapeutiques : dénouer le nœud systémique
La thérapie familiale systémique : recadrer le symptôme
L’approche systémique stratégique propose une lecture radicalement différente du symptôme de l’enfant, le considérant non comme un dysfonctionnement individuel mais comme l’expression d’une dynamique familiale problématique. Cette perspective permet un recadrage thérapeutique puissant, déplaçant le focus de l’enfant “problématique” vers le système relationnel dans son ensemble.
Comme le souligne l’article sur l’adaptation du diagnostic interactionnel dans une organisation, cette lecture systémique permet d’identifier les patterns interactionnels qui maintiennent le symptôme et d’intervenir stratégiquement pour les modifier.
Les prescriptions paradoxales : déstabiliser pour reconstruire
Les prescriptions paradoxales constituent l’une des techniques d’intervention privilégiées de l’approche stratégique pour déstabiliser les systèmes rigides. En prescrivant de manière contrôlée le symptôme ou le pattern problématique, le thérapeute permet à la famille de reprendre le contrôle sur des comportements qui semblaient échapper à toute maîtrise.
Par exemple, face à un enfant qui développe des crises d’angoisse systématiquement lors des disputes parentales, le thérapeute pourrait prescrire aux parents de planifier une “dispute contrôlée” à un moment précis, tout en demandant à l’enfant d’observer attentivement ses réactions. Cette prescription paradoxale permet de désamorcer le caractère automatique et inconscient du symptôme, tout en révélant sa fonction dans le système familial. L’article sur la formation systémique et l’exemple de prescription “chercher un signe de rejet” illustre brillamment l’efficacité de ces interventions paradoxales pour modifier les patterns relationnels dysfonctionnels.
Le dialogue stratégique : une voie royale vers le changement
Le dialogue stratégique, développé par Giorgio Nardone, représente une modalité d’intervention particulièrement efficace pour dénouer les impasses relationnelles dans lesquelles l’enfant-symptôme est pris. Cette forme structurée de communication thérapeutique vise à induire des changements perceptifs qui modifieront ensuite les comportements problématiques. En guidant les parents à travers une série de questions stratégiques, le thérapeute les amène à découvrir par eux-mêmes les patterns relationnels qui maintiennent le symptôme de l’enfant. Cette prise de conscience, lorsqu’elle émerge comme une découverte personnelle plutôt que comme une interprétation imposée, possède un puissant potentiel de changement.
Études de cas : illustrations cliniques
Cas 1 : Léa et les maux de ventre diplomatiques
Léa, 8 ans, consulte pour des douleurs abdominales récurrentes ayant entraîné de nombreuses absences scolaires. Les examens médicaux n’ont révélé aucune cause organique. L’exploration systémique met en lumière que ces symptômes surviennent principalement les lundis et jeudis, jours où les parents, en instance de divorce mais vivant encore sous le même toit, se retrouvent simultanément au domicile.
L’analyse des interactions révèle que les douleurs de Léa permettent d’éviter les confrontations parentales : la mère accuse le père de stress excessif, tandis que le père reproche à la mère son laxisme éducatif. Léa, au centre de ce conflit, devient le “symptôme-médiateur” qui permet au couple de communiquer indirectement à travers sa souffrance.
L’intervention thérapeutique a consisté à prescrire aux parents de discuter explicitement de leurs désaccords éducatifs pendant 30 minutes deux fois par semaine, en l’absence de Léa, tout en tenant un journal de ces échanges. Parallèlement, Léa a été encouragée à tenir un “journal des jours sans douleur”, déplaçant ainsi son attention des symptômes vers les ressources.
En quelques semaines, les douleurs abdominales ont diminué significativement, tandis que les parents ont développé un mode de communication plus direct concernant leurs responsabilités parentales, malgré leur séparation conjugale.
Cas 2 : Thomas et le refus scolaire anxieux
Thomas, 14 ans, présente un refus scolaire anxieux depuis plusieurs mois. Brillant élève jusqu’alors, il développe des crises d’angoisse intenses à l’idée de se rendre au collège. Les tentatives parentales pour le rassurer ou le contraindre n’ont fait qu’aggraver la situation.
L’évaluation systémique révèle que cette symptomatologie est apparue peu après que le père, cadre supérieur, ait été licencié, événement coïncidant avec une promotion professionnelle importante de la mère. Ce bouleversement des statuts professionnels a généré des tensions conjugales significatives, le père éprouvant un sentiment d’échec tandis que la mère culpabilise de sa réussite.
Dans ce contexte, le symptôme de Thomas peut être interprété comme une tentative de rééquilibrage du système familial : en devenant lui-même “défaillant”, il permet à son père de retrouver une fonction parentale valorisante (l’accompagnement de son fils en difficulté) tout en offrant à sa mère l’occasion de relativiser sa réussite professionnelle face à cette “urgence familiale”.
L’intervention thérapeutique s’est articulée autour d’une prescription paradoxale : plutôt que de lutter contre l’anxiété scolaire, les parents ont été invités à organiser un “programme d’enseignement à domicile temporaire” structuré, où le père, mobilisant ses compétences professionnelles, prenait en charge certaines matières. Parallèlement, un travail sur les 5 axiomes de la communication a été mené avec le couple parental pour clarifier leurs échanges autour des bouleversements professionnels.
Cette intervention a permis de valoriser les compétences du père tout en désamorçant la fonction stabilisatrice du symptôme de Thomas. Progressivement, l’adolescent a pu réintégrer le milieu scolaire, tandis que ses parents développaient une communication plus authentique autour de leurs transitions professionnelles respectives.
Les pièges de la prise en charge : écueils et vigilances
Le risque de l’étiquetage diagnostic
L’un des principaux écueils dans la prise en charge de l’enfant-symptôme réside dans la tentation de l’étiquetage diagnostic. En focalisant exclusivement l’attention sur l’enfant et son symptôme, on risque de renforcer ce que l’article “Santé mentale : remettre en question les dangers des étiquettes” dénonce comme une “prophétie auto-réalisatrice pathologisante”.Comme le souligne cet article, “l’étiquette diagnostique, loin d’être une simple description neutre, devient parfois un élément constitutif de l’identité de la personne”. Dans le cas de l’enfant-symptôme, cette réification diagnostique peut paradoxalement consolider sa fonction dans l’équilibre familial dysfonctionnel, le figeant dans un rôle de “porteur de problème” qui déresponsabilise le reste du système.
La collusion thérapeutique : quand le thérapeute renforce le symptôme
Un autre piège majeur consiste en la collusion thérapeutique avec le système familial. Le thérapeute, en acceptant implicitement la désignation de l’enfant comme “patient identifié”, peut involontairement contribuer à maintenir l’homéostasie dysfonctionnelle du système.
Cette collusion peut prendre plusieurs formes :
- L’alliance exclusive avec les parents contre le symptôme de l’enfant
- L’alliance avec l’enfant contre les “mauvaises pratiques parentales”
- La focalisation technique sur le symptôme au détriment de sa fonction systémique
Pour éviter ces écueils, le thérapeute doit maintenir une position de “méta-neutralité”, comme le préconise l’approche systémique stratégique, en s’alliant non pas avec les personnes mais avec le processus de changement lui-même.
Perspectives préventives : soutenir la conjugalité parentale
Prévention primaire : accompagner la transition à la parentalité
La prévention des dynamiques où l’enfant devient le symptôme du couple passe nécessairement par un accompagnement de la transition à la parentalité. Un essai contrôlé randomisé impliquant 399 couples (Feinberg, 2016) a démontré l’efficacité d’un programme de prévention ciblant cette transition critique : les couples ayant bénéficié de l’intervention ont montré de meilleurs résultats sur la coparentalité, la santé mentale parentale et l’ajustement de l’enfant.
L’approche systémique en milieu scolaire propose également des interventions préventives qui sensibilisent les parents aux enjeux relationnels de la parentalité, avant même l’apparition de symptômes chez l’enfant.
Soutenir la différenciation conjugale et parentale
Un axe préventif essentiel consiste à aider les couples à maintenir une différenciation claire entre leur relation conjugale et leur relation coparentale. Comme le souligne Robert Neuburger dans son approche des couples et familles, la confusion entre ces deux registres relationnels constitue le terreau fertile où germent les triangulations pathogènes.
Cette différenciation implique :
- La préservation d’un espace conjugal distinct de l’espace parental
- La capacité à gérer les conflits conjugaux sans y impliquer les enfants
- Le développement d’une coparentalité collaborative malgré d’éventuelles tensions conjugales
La thérapie brève systémique : une réponse efficace et économique
Efficacité démontrée de l’approche systémique stratégique
L’efficacité de l’approche systémique stratégique dans le traitement des situations où l’enfant devient le symptôme du couple parental est aujourd’hui largement documentée. Selon les données rapportées dans “Thérapie brève systémique stratégique” (Vitry, 2024), cette approche permet d’obtenir des résultats significatifs dans 74% des cas en moins de 10 séances.
Cette efficience thérapeutique s’explique notamment par :
- La focalisation sur les interactions plutôt que sur les caractéristiques individuelles
- L’utilisation stratégique des résistances au changement
- L’intervention sur les tentatives de solution dysfonctionnelles plutôt que sur les causes présumées du problème
Intégration des approches : systémique, hypnose et thérapie narrative
Pour optimiser l’efficacité thérapeutique dans ces situations complexes, l’intégration de différentes approches complémentaires s’avère particulièrement féconde. L’hypnose ericksonienne, avec son utilisation des métaphores et sa capacité à mobiliser les ressources inconscientes, offre des outils précieux pour accompagner tant les parents que l’enfant dans leur processus de changement.
De même, l’approche narrative permet de co-construire avec la famille de nouveaux récits qui ne sont plus organisés autour du symptôme de l’enfant, mais autour des ressources et des compétences de chacun. Cette reconstruction narrative constitue un puissant levier de transformation des dynamiques familiales dysfonctionnelles.
Conclusion : libérer l’enfant de sa fonction symptomatique
Lorsque l’enfant devient le symptôme du couple parental, il se trouve prisonnier d’une fonction qui entrave son développement autonome. La souffrance qu’il exprime à travers son symptôme n’est pas seulement la sienne, mais aussi celle d’un système familial en quête d’équilibre.
L’approche systémique stratégique, en déplaçant le regard du symptôme vers sa fonction dans le système, offre une voie thérapeutique particulièrement prometteuse. Elle permet de libérer l’enfant de sa mission impossible – stabiliser le couple parental – tout en accompagnant les parents vers une relation conjugale et parentale plus différenciée et fonctionnelle.
Si vous reconnaissez dans cet article des dynamiques familiales qui vous concernent, sachez que des professionnels formés à l’approche systémique peuvent vous accompagner. Les consultations LACT offrent un espace thérapeutique où ces dynamiques complexes peuvent être abordées avec bienveillance et efficacité, permettant à chaque membre de la famille de retrouver sa place et son autonomie.

Références
Auersperg, F. (2019). Long-term effects of parental divorce on mental health - A meta-analysis. Journal of Psychiatric Research, 119, 107-115.
Feinberg, M. (2016). Couple-Focused Prevention at the Transition to Parenthood. Family Process, 55(3), 500-515.
Rappaport, C. (2020). L’enfant co-victime de féminicide/homicide au sein du couple parental. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 68(7), 328-335.
Vitry, G. et al. (2024). Le grand livre du diagnostic systémique et de l‘intervention stratégique. Dunod.
Vitry, G. (2024). Thérapie brève systémique stratégique. De Boeck.
Vitry, G. et al. (2023). Comprendre et soigner les addictions. Dunod.
Watzlawick, P. et al. (1972). Une logique de la communication. Seuil.