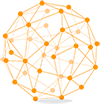La procrastination, cette tendance à remettre systématiquement à plus tard ce que l’on pourrait faire maintenant, constitue l’un des comportements humains les plus universels et pourtant des plus mystérieux. Qui n’a jamais repoussé une tâche importante au profit d’activités plus agréables ou moins anxiogènes ? Mais lorsque ce comportement devient chronique, transformant l’exception en règle, nous entrons dans un territoire clinique particulier où l’évitement devient un véritable art de vivre.

Comme le soulignait Robert Neuburger lors d’une conférence à LACT : “Le procrastinateur n’est pas paresseux, il est extraordinairement actif… à faire tout sauf ce qu’il devrait faire.” Cette boutade cache une vérité profonde : la procrastination chronique n’est pas une simple paresse, mais un mécanisme complexe d’évitement qui mérite d’être analysé sous l’angle systémique.
La procrastination : bien plus qu’une simple paresse
Définition et prévalence : un phénomène massif
La procrastination chronique se définit comme le report systématique et contre-productif d’actions importantes malgré la conscience des conséquences négatives. Ce phénomène toucherait entre 15 et 20% de la population adulte générale, avec des pics à 70% chez les étudiants pour les tâches académiques (Steel, 2007). Ces chiffres impressionnants suggèrent que nous sommes face à un phénomène massif, presque normalisé dans certains contextes.
“Le grand livre du diagnostic systémique et de l’intervention stratégique” rappelle que “la procrastination n’est pas un trouble officiellement répertorié dans le DSM, mais qu’elle constitue un symptôme transversal présent dans de nombreux troubles anxieux et dépressifs” (Steel, 2007). Cette absence de classification spécifique complique parfois sa reconnaissance comme problématique nécessitant une intervention.
Les trois visages du procrastinateur
La recherche a identifié trois profils distincts de procrastinateurs chroniques :
- Le procrastinateur évitant : il repousse les tâches par peur de l’échec ou du jugement. Ce report est motivé par la protection de l’estime de soi.
- Le procrastinateur par excitation : il attend la dernière minute pour agir, recherchant l’adrénaline de l’urgence comme moteur d’action.
- Le procrastinateur décisionnel : il reporte spécifiquement les prises de décision importantes, paralysé par la crainte de faire le mauvais choix.
Comme l’explique Steel dans son analyse théorique, “la procrastination représente l’échec quintessentiel de l’autorégulation” (Steel, 2007). Cette formulation souligne que le cœur du problème n’est pas tant la gestion du temps que la gestion des émotions négatives associées à certaines tâches.
L’évitement comme stratégie
Le paradoxe de l’évitement productif
L’une des caractéristiques les plus fascinantes de la procrastination chronique est ce que nous pourrions appeler “l’évitement productif”. Le procrastinateur n’est pas inactif - bien au contraire. Il déploie souvent une énergie considérable dans des activités alternatives, parfois même utiles ou productives, mais qui servent principalement à éviter la tâche redoutée.
Comme l’observe l’équipe de LACT dans ses analyses des comportements d’évitement, “le procrastinateur chronique devient expert dans l’art de se mentir à lui-même, construisant des justifications élaborées pour légitimer ses reports”. Cette auto-illusion constitue un mécanisme de défense sophistiqué qui protège temporairement l’estime de soi, tout en aggravant le problème à long terme.
La peur cachée derrière l’évitement
Que cherche réellement à éviter le procrastinateur chronique ? Les recherches convergent vers plusieurs peurs fondamentales :
- La peur de l’échec : éviter la tâche permet d’éviter la confrontation avec ses propres limites
- La peur du succès : paradoxalement, réussir peut générer des attentes plus élevées, source d’anxiété
- La peur du jugement : l’évaluation par autrui représente une menace pour l’image de soi
- L’aversion pour la tâche : certaines activités génèrent un inconfort émotionnel immédiat que l’on cherche à éviter
Cette dimension émotionnelle est cruciale pour comprendre pourquoi les approches purement cognitives ou organisationnelles échouent souvent. Les spécialistes des troubles anxieux ont depuis longtemps identifié que l’évitement renforce paradoxalement l’anxiété qu’il cherche à apaiser.
Le cycle infernal de la procrastination
Un système auto-entretenu
Dans une perspective systémique, la procrastination chronique peut être conceptualisée comme un système auto-entretenu où chaque élément renforce les autres. Ce cycle typique se déroule généralement ainsi :
- Intention : le sujet forme l’intention d’accomplir une tâche
- Inconfort émotionnel : la tâche génère une anticipation anxieuse
- Évitement : pour soulager cet inconfort, le sujet s’engage dans une activité alternative
- Soulagement temporaire : l’évitement produit un apaisement immédiat
- Conséquences négatives : à mesure que l’échéance approche, la pression augmente
- Culpabilité et autocritique : le sujet se blâme pour son comportement
- Baisse de l’estime de soi : la répétition du cycle érode la confiance en ses capacités
- Renforcement du besoin d’évitement : le cycle recommence, amplifié
Ce que les spécialistes de l’approche systémique nomment une “solution qui devient le problème” est parfaitement illustré ici : la tentative de solution (l’évitement) devient elle-même le cœur du problème.
Les coûts cachés de la procrastination chronique
Les conséquences de la procrastination chronique dépassent largement le simple retard dans l’accomplissement des tâches. Les recherches ont identifié de nombreux impacts :
- Stress accru : paradoxalement, reporter pour éviter le stress génère davantage de stress
- Performances diminuées : la qualité du travail souffre des contraintes temporelles
- Problèmes de santé : Tice et Baumeister (1997) ont démontré que les procrastinateurs chroniques présentent davantage de problèmes de santé physique
- Détresse psychologique : anxiété, dépression et baisse de l’estime de soi sont fréquemment associées
- Difficultés relationnelles : les reports constants affectent la confiance des autres
Comme le souligne l’étude de Sirois et Pychyl (2016), la procrastination chronique représente “une forme de mauvais traitement de soi” où le soi présent sabote systématiquement le bien-être du soi futur.
Comprendre la procrastination par le prisme systémique
Au-delà du symptôme individuel
L’approche systémique nous invite à considérer la procrastination chronique non comme un simple défaut de caractère, mais comme un symptôme s’inscrivant dans un système plus large d’interactions. Cette perspective est particulièrement pertinente pour comprendre pourquoi certaines personnes développent ce comportement dans certains contextes spécifiques. Par exemple, dans un système familial où la perfection est implicitement exigée, la procrastination peut devenir une stratégie pour éviter d’être jugé sur ses performances. De même, dans un environnement professionnel toxique, reporter certaines tâches peut constituer une forme de résistance passive.
La double contrainte du procrastinateur
Un concept particulièrement éclairant pour comprendre la procrastination chronique est celui de la double contrainte, théorisée par Gregory Bateson. Le procrastinateur se trouve souvent pris dans une injonction paradoxale :
- “Tu dois réussir parfaitement cette tâche” (message explicite)
- “Tu n’as pas les compétences nécessaires pour y parvenir” (message implicite, souvent intériorisé)
Face à cette contradiction insoluble, la procrastination devient une “solution” qui permet de ne jamais tester réellement ses capacités. L’échec peut toujours être attribué au manque de temps plutôt qu’à un manque de compétence, préservant ainsi une image de soi fragile.
Évaluation et diagnostic de la procrastination chronique
Distinguer procrastination occasionnelle et chronique
Pour déterminer si la procrastination a atteint un niveau pathologique nécessitant une intervention, plusieurs critères peuvent être considérés :
- Fréquence et persistance : le comportement est-il systématique plutôt qu’occasionnel ?
- Impact fonctionnel : interfère-t-il significativement avec le fonctionnement personnel, académique ou professionnel ?
- Détresse subjective : génère-t-il une souffrance psychologique importante ?
- Résistance aux tentatives de changement : persiste-t-il malgré les efforts pour le modifier ?
Procrastination et comorbidités : un symptôme révélateur
La procrastination chronique apparaît rarement de façon isolée. Elle est fréquemment associée à d’autres problématiques psychologiques :
- Troubles anxieux : notamment le trouble d’anxiété généralisée et la phobie sociale
- Dépression : où elle peut refléter la perte de motivation et d’énergie
- TDAH : où elle traduit les difficultés d’organisation et d’initiation des tâches
- Perfectionnisme dysfonctionnel : où elle sert à éviter la confrontation avec des standards inatteignables
- Doute pathologique : où l’incertitude paralyse la prise de décision
Comme le souligne l’équipe de LACT dans ses travaux sur le perfectionnisme dysfonctionnel, “la procrastination peut constituer le symptôme visible d’un système de croyances rigides sur la performance et l’échec”.
Interventions thérapeutiques : l’approche systémique stratégique
Dépasser les approches conventionnelles
Les approches traditionnelles de la procrastination se concentrent souvent sur des techniques de gestion du temps, de planification ou de motivation. Si ces outils peuvent être utiles, ils échouent généralement à traiter les mécanismes profonds d’évitement émotionnel qui sous-tendent le comportement.
L’approche systémique stratégique propose une perspective radicalement différente, s’intéressant moins au “pourquoi” de la procrastination qu’au “comment” elle se maintient dans le présent. Comme l’explique Knaus (2002), “comprendre l’origine historique de la procrastination est moins important que d’identifier les mécanismes qui la perpétuent aujourd’hui”.
Techniques d’intervention systémique
Plusieurs techniques issues de l’approche systémique et stratégique se révèlent particulièrement efficaces :
1. Le recadrage
Cette technique consiste à modifier le cadre de référence à travers lequel le patient perçoit son comportement. Par exemple, recadrer la procrastination non comme une “paresse” mais comme une “stratégie de protection” permet de diminuer la culpabilité et d’explorer les peurs sous-jacentes.
2. La prescription du symptôme
Paradoxalement, prescrire au patient de procrastiner délibérément (dans un cadre contrôlé) peut briser le cycle automatique du comportement. Cette technique, issue des travaux de l’École de Palo Alto, permet de transformer un comportement involontaire en choix conscient, redonnant ainsi un sentiment de contrôle.
3. Le dialogue stratégique
Développé par Giorgio Nardone, le dialogue stratégique utilise des questions spécifiques pour amener le patient à découvrir par lui-même les contradictions dans sa logique d’évitement. Cette maïeutique moderne permet de contourner les résistances habituelles au changement.
4. L’utilisation des exceptions
Cette technique consiste à identifier les situations où le patient ne procrastine pas, puis à analyser minutieusement ce qui distingue ces moments des situations problématiques. Ces “exceptions à la règle” contiennent souvent la clé du changement.
5. Les tâches graduées
Plutôt que d’affronter directement la tâche redoutée, le patient est invité à s’engager dans une série d’étapes progressives, chacune légèrement plus difficile que la précédente. Cette approche, similaire à l’exposition graduelle utilisée dans les phobies, permet de désensibiliser progressivement l’anxiété associée à la tâche.
L’hypnose comme complément thérapeutique
L’hypnose ericksonienne offre un complément précieux à l’intervention systémique. Elle permet notamment de :
- Accéder aux ressources inconscientes du patient
- Modifier les associations émotionnelles liées aux tâches redoutées
- Renforcer la projection dans le futur (imaginer la satisfaction de l’accomplissement)
- Travailler sur l’identité du patient au-delà de son comportement procrastinateur
Comme le souligne Bruno Dubos, “l’hypnose permet de contourner les résistances conscientes et d’installer de nouvelles associations entre l’action et le plaisir, là où existait auparavant une association entre l’action et l’inconfort”.
Cas cliniques : la procrastination en action
Le cas de Thomas : procrastination et perfectionnisme
Thomas, ingénieur de 34 ans, consulte pour une procrastination chronique qui menace sa carrière. Brillant mais perpétuellement en retard dans ses livrables, il passe des heures à peaufiner des détails mineurs tout en reportant les décisions importantes. L’analyse systémique révèle un système familial où l’excellence était la seule option acceptable, créant une équation implicite “perfection ou échec”.
L’intervention a consisté à :
- Recadrer son perfectionnisme comme une “loyauté familiale” plutôt qu’un trait personnel
- Prescrire des “imperfections délibérées” dans des contextes à faible enjeu
- Utiliser le dialogue stratégique pour explorer sa peur du jugement
- Mettre en place un système de “temps limité” plutôt que de “tâche parfaite”
Après 12 séances, Thomas a développé une nouvelle relation au travail, privilégiant l’efficacité à la perfection. Sa procrastination, sans disparaître complètement, a diminué suffisamment pour ne plus interférer avec sa performance professionnelle.
Le cas de Sophie : procrastination et évitement du conflit
Sophie, 28 ans, reporte systématiquement les conversations difficiles avec son conjoint, créant un cycle de ressentiment et d’évitement. Son histoire familiale révèle un modèle où les conflits n’étaient jamais résolus mais simplement évités, créant l’illusion d’une harmonie de façade.
L’intervention systémique a ciblé :
- L’identification des croyances limitantes sur le conflit (“un désaccord signifie la fin de la relation”)
- L’apprentissage graduel de l’expression des besoins
- La prescription paradoxale de “moments de désaccord planifiés”
- Le recadrage du conflit comme opportunité d’intimité plutôt que menace
Cette approche a permis à Sophie de reconnaître que sa procrastination relationnelle servait une fonction protectrice qu’elle pouvait maintenant abandonner au profit de stratégies plus adaptatives.
Les défis spécifiques de notre époque digitale
Procrastination et technologies : une tempête parfaite
Notre environnement numérique crée des conditions particulièrement propices à la procrastination chronique. Plusieurs facteurs y contribuent :
- Disponibilité immédiate des distractions : les réseaux sociaux, vidéos et jeux sont accessibles en un clic
- Gratification instantanée : ces activités offrent une récompense immédiate que les tâches importantes n’apportent que différée
- Surcharge informationnelle : l’abondance d’informations crée une paralysie décisionnelle
- Fragmentation de l’attention : les notifications constantes interrompent le flux de concentration
Comme l’explique l’équipe de LACT dans ses analyses des comportements numériques, “les technologies numériques exploitent précisément les vulnérabilités de notre système de récompense cérébral, créant une boucle de renforcement particulièrement difficile à briser”.
Stratégies d’intervention adaptées à l’ère numérique
Face à ces défis spécifiques, plusieurs stratégies systémiques peuvent être adaptées :
- L’écologie numérique : restructurer l’environnement digital pour réduire les tentations (blocage d’applications, désactivation des notifications)
- La technique du contraste mental : développée par Gabriele Oettingen, elle consiste à visualiser alternativement le résultat désiré et les obstacles, créant une tension motivationnelle
- Le “nudging” comportemental : mettre en place de petites modifications environnementales qui facilitent le comportement souhaité
- La méthode Pomodoro systémique : adapter la célèbre technique de gestion du temps en y intégrant une réflexion sur les patterns d’évitement spécifiques au patient
- L’utilisation stratégique de la technologie : transformer l’outil de procrastination en allié (applications de productivité, suivi des progrès)
Ces approches reconnaissent que la solution ne réside pas dans un rejet total de la technologie, mais dans une modification de la relation que le sujet entretient avec elle.
Procrastination et monde professionnel
Un coût organisationnel sous-estimé
La procrastination chronique représente un coût considérable pour les organisations. Selon les estimations, elle serait responsable d’une perte de productivité évaluée entre 8 000 et 12 000 dollars par employé et par an (Steel, 2007). Au-delà de l’aspect financier, elle affecte également :
- La qualité du travail fourni
- Le moral des équipes (quand certains membres reportent systématiquement leurs contributions)
- L’innovation (les projets créatifs étant particulièrement vulnérables à la procrastination)
- La satisfaction professionnelle globale
Les spécialistes du management systémique soulignent que la procrastination est souvent le symptôme de dysfonctionnements organisationnels plus larges : objectifs flous, feedback insuffisant, culture de la perfection, ou manque d’autonomie.
Interventions en milieu professionnel
L’approche systémique offre des perspectives particulièrement pertinentes en contexte professionnel :
- Analyse des patterns organisationnels : identifier les facteurs systémiques qui favorisent la procrastination (délais irréalistes, objectifs contradictoires)
- Restructuration des systèmes de feedback : privilégier les retours fréquents et constructifs plutôt que les évaluations ponctuelles à fort enjeu
- Coaching systémique : accompagner les managers dans l’identification et la modification des dynamiques d’équipe qui entretiennent la procrastination
- Formation aux compétences métacognitives : développer la capacité des collaborateurs à reconnaître et gérer leurs tendances procrastinatrices
Comme le souligne Claude de Scorraille dans “Quand le travail fait mal” (2017), “les comportements d’évitement au travail sont souvent des tentatives adaptatives face à des contextes inadaptés. Transformer le système plutôt que blâmer l’individu constitue alors la voie thérapeutique la plus efficace.”
Le paradoxe de la procrastination créative
Quand reporter devient productif
Un aspect fascinant de la procrastination est ce que certains chercheurs ont nommé la “procrastination active” ou “procrastination structurée”. Ce phénomène, décrit notamment par John Perry (2012), suggère que certaines formes de report peuvent paradoxalement stimuler la créativité et la productivité.
Comme l’explique l’équipe de LACT dans ses analyses des paradoxes comportementaux, “la période d’incubation que procure la procrastination peut permettre au cerveau de faire des connexions inattendues, particulièrement précieuses dans les tâches créatives”.
Cette observation rejoint le concept systémique de “fonction du symptôme” : même un comportement apparemment dysfonctionnel peut servir une fonction adaptative qu’il convient d’identifier avant de chercher à l’éliminer.
Distinguer procrastination fonctionnelle et dysfonctionnelle
L’approche systémique nous invite à évaluer la procrastination non pas selon des critères moraux (bien/mal) mais fonctionnels (utile/inutile dans un contexte donné). Plusieurs critères permettent de distinguer ces deux formes :
- L’intentionnalité : la procrastination fonctionnelle est souvent délibérée et stratégique
- Le niveau de stress : la forme dysfonctionnelle s’accompagne d’une détresse significative
- Les conséquences : l’impact sur la qualité du travail et les relations est déterminant
- La flexibilité : la capacité à sortir du pattern quand nécessaire est cruciale
Cette nuance est importante en thérapie : l’objectif n’est pas nécessairement d’éliminer toute forme de procrastination, mais de transformer une procrastination subie et anxiogène en une gestion flexible et stratégique du temps et de l’énergie.
Conclusion : vers une approche intégrative
La procrastination chronique, loin d’être un simple défaut de caractère ou un manque de volonté, apparaît comme une stratégie d’évitement sophistiquée, profondément ancrée dans nos mécanismes de protection émotionnelle. L’approche systémique, en s’intéressant aux patterns interactionnels qui maintiennent ce comportement, offre une perspective particulièrement féconde pour comprendre et transformer ce cycle auto-entretenu.
Comme nous l’avons exploré, la procrastination peut servir diverses fonctions : protection de l’estime de soi, évitement de l’anxiété, expression indirecte de résistance, ou même incubation créative. Reconnaître ces fonctions constitue la première étape d’une intervention efficace.
Les techniques systémiques et stratégiques, complétées par des approches comme l’hypnose ericksonienne, permettent d’intervenir non pas en combattant frontalement le symptôme, mais en modifiant subtilement le système qui le maintient. Cette approche indirecte contourne les résistances habituelles et favorise un changement durable.
Si vous vous reconnaissez dans les patterns décrits dans cet article, sachez que la procrastination chronique n’est pas une fatalité. Les consultations spécialisées offrent aujourd’hui des perspectives thérapeutiques prometteuses, permettant de transformer ce qui était une stratégie d’évitement en une gestion consciente et flexible de vos ressources attentionnelles et émotionnelles.
Comme le disait Robert Neuburger : “Le problème n’est pas tant de remettre à demain ce qu’on peut faire aujourd’hui, mais de ne jamais faire aujourd’hui ce qu’on a remis à hier.” Il est peut-être temps de briser ce cycle, non pas en luttant contre vous-même, mais en comprenant et en transformant les patterns qui maintiennent cette danse de l’évitement.
Références
Baumeister, R. F., & Tierney, J. (2011). Willpower: Rediscovering the greatest human strength. Penguin.
de Scorraille, C. et al. (2017). Quand le travail fait mal. InterÉditions.
Ferrari, J. R., & Tice, D. M. (2000). Procrastination as a self-handicap for men and women: A task-avoidance strategy in a laboratory setting. Journal of Research in Personality, 34, 73-83.
Ferrari, J. R., Johnson, J. L., & McCown, W. G. (1995). Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. Springer.
Ferrari, J. R., O’Callaghan, J., & Newbegin, I. (2005). Prevalence of procrastination in the United States, United Kingdom, and Australia: Arousal and avoidance delays among adults. North American Journal of Psychology, 7, 1-6.
Knaus, W. J. (2002). The procrastination workbook: Your personalized program for breaking free from the patterns that hold you back. New Harbinger Publications.
Oettingen, G. (2014). Rethinking positive thinking: Inside the new science of motivation. Current.
Perry, J. (2012). The art of procrastination: A guide to effective dawdling, lollygagging, and postponing. Workman Publishing.
Sirois, F. M., & Pychyl, T. A. (2016). Procrastination, health, and well-being. Academic Press.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65-94.
Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological Science, 8, 454-458.
Vitry, G. et al. (2024). Le grand livre du diagnostic systémique et de l’intervention stratégique. Dunod.
Vitry, G. (2019). Stratégie du changement. Erès.
Zhou, M., & Kam, C. (2017). Trait procrastination, self-efficacy and achievement goals: the mediation role of boredom coping strategies. Educational Psychology, 37, 854-872.