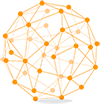Le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) représente bien plus qu’une simple réaction à un événement traumatique. Il s’agit d’un véritable bouleversement systémique qui affecte l’individu dans sa globalité, perturbant ses relations, son rapport au monde et sa perception de lui-même. Dans une lecture systémique, ce n’est pas tant l’événement traumatique lui-même qui détermine l’apparition du trouble, mais plutôt la manière dont cet événement s’inscrit dans le système de croyances et de relations de la personne.
Dans cette perspective, le TSPT peut être compris comme un “chaos organisé” - un ensemble de symptômes qui, bien que dévastateurs, suivent une logique propre et remplissent une fonction paradoxale de protection. Selon la théorie des systèmes, tout comportement, même dysfonctionnel, possède une fonction adaptative dans son contexte d’origine.
L’approche systémique offre un cadre particulièrement pertinent pour comprendre et traiter le TSPT, car elle permet d’appréhender le trouble dans sa complexité, en tenant compte des multiples facteurs qui contribuent à son maintien. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes, elle s’intéresse aux patterns relationnels, aux tentatives de solution inefficaces et aux boucles de rétroaction qui maintiennent la personne dans un état de souffrance.

Le TSPT : un système verrouillé par ses propres tentatives de solution
La logique paradoxale du traumatisme
Le TSPT se caractérise par une constellation de symptômes incluant les reviviscences, l’évitement, l’hypervigilance et les altérations négatives des cognitions et de l’humeur. Ces symptômes, loin d’être aléatoires, forment un système cohérent qui s’auto-entretient. Or, ce sont souvent les “tentatives de solution” mises en place par la personne qui contribuent à maintenir le problème. Par exemple, l’évitement des situations rappelant le traumatisme, bien qu’apportant un soulagement immédiat, renforce à long terme la peur et empêche tout processus d’habituation ou de réélaboration de l’expérience traumatique.
Cette dynamique illustre parfaitement ce que Watzlawick, figure emblématique de l’École de Palo Alto, appelle “les cinq axiomes de la communication”, notamment le principe selon lequel “la solution devient le problème”. Dans le cas du TSPT, les stratégies d’évitement, initialement protectrices, deviennent progressivement le cœur du problème.
L’impact systémique du traumatisme
Le TSPT ne se limite pas à la sphère individuelle mais affecte l’ensemble du système relationnel de la personne. Les études montrent que le TSPT post-partum touche environ 9,3% des primipares (Chakroun, 2021), illustrant comment un événement normalement associé à la joie peut devenir traumatique dans certains contextes. Les facteurs systémiques tels que les antécédents médicaux, le contexte de l’accouchement et le soutien postnatal influencent significativement le risque de développer un TSPT.
Ce trouble peut également engendrer ce que les systémiciens appellent “le paradoxe de la victoire épuisante”, où la personne s’épuise à lutter contre ses symptômes, obtenant parfois des victoires à court terme mais au prix d’un épuisement croissant.
Déconstruire le chaos : l’approche systémique en action
Le recadrage comme outil de transformation
L’une des forces de l’approche systémique réside dans sa capacité à recadrer l’expérience traumatique. Plutôt que de voir les symptômes comme des signes de faiblesse ou de pathologie, ils sont reconceptualisés comme des tentatives d’adaptation à une situation extrême. Ce recadrage permet de dépathologiser l’expérience de la personne et d’ouvrir la voie à de nouvelles perspectives. Comme le suggère la thérapie brève stratégique, il ne s’agit pas tant de comprendre pourquoi le problème est apparu, mais plutôt comment il se maintient et comment il peut être résolu.
Briser les cercles vicieux
L’approche systémique s’attache à identifier et à interrompre les cercles vicieux qui maintiennent le TSPT. Par exemple, l’hypervigilance conduit souvent à une interprétation catastrophique des sensations corporelles, ce qui augmente l’anxiété et renforce l’hypervigilance. Ce mécanisme est particulièrement visible dans les attaques de panique associées au TSPT, comme l’illustre cet exemple de traitement d’une attaque de panique.
Pour briser ces cercles vicieux, les thérapeutes systémiques utilisent diverses stratégies, notamment les prescriptions paradoxales et les tâches comportementales. Ces interventions visent à perturber les patterns dysfonctionnels et à introduire de la nouveauté dans le système.
L’importance du contexte relationnel
Contrairement aux approches qui se concentrent exclusivement sur l’individu, l’approche systémique reconnaît l’importance cruciale du contexte relationnel dans le maintien et la résolution du TSPT. Les relations peuvent soit exacerber les symptômes, soit faciliter le rétablissement.
Cette perspective est particulièrement pertinente dans les cas de traumatismes relationnels, comme le harcèlement moral. L’accompagnement des victimes de harcèlement moral nécessite une compréhension fine des dynamiques relationnelles en jeu et une intervention qui prend en compte l’ensemble du système.
Sortir du chaos : stratégies systémiques pour le traitement du TSPT
La thérapie brève stratégique : une approche pragmatique
La thérapie brève stratégique, issue de la tradition systémique, offre une approche particulièrement efficace pour le traitement du TSPT. Plutôt que de se focaliser sur l’exploration approfondie du traumatisme, elle se concentre sur les solutions et sur la modification des patterns comportementaux et cognitifs qui maintiennent le problème.
Cette approche repose sur le principe que de petits changements dans un élément du système peuvent entraîner des modifications significatives dans l’ensemble du système. Ainsi, en modifiant la façon dont la personne réagit à ses symptômes, on peut progressivement transformer l’ensemble de son expérience.
Le dialogue stratégique : dénouer les nœuds du traumatisme
Le dialogue stratégique, développé par Giorgio Nardone, constitue un outil puissant pour aider les personnes souffrant de TSPT à sortir du chaos. Cette technique d’entretien structurée permet de guider la personne vers la découverte de nouvelles perspectives et de nouvelles solutions. À travers une série de questions soigneusement formulées, le thérapeute amène la personne à remettre en question ses perceptions rigides et à envisager de nouvelles façons de faire face à son expérience traumatique. Ce processus facilite ce que les systémiciens appellent “le doute libérateur”, qui permet de sortir des certitudes pathologiques.
L’hypnose conversationnelle : accéder aux ressources inconscientes
L’hypnose conversationnelle, intégrée à l’approche systémique, offre un moyen puissant d’accéder aux ressources inconscientes de la personne. Comme l’explique cette ressource sur la compréhension et le soin des peurs avec l’hypnose conversationnelle, cette approche permet de contourner les résistances conscientes et d’introduire de nouvelles perspectives de manière indirecte.
Dans le traitement du TSPT, l’hypnose peut aider à moduler les réactions émotionnelles intenses, à transformer les images traumatiques et à renforcer les ressources de la personne. Elle s’inscrit parfaitement dans la logique systémique en ce qu’elle s’intéresse aux patterns de perception et de réaction plutôt qu’aux contenus spécifiques.
Mesurer le changement : l’échelle PRS comme boussole thérapeutique
Un outil d’évaluation dynamique
L’échelle PRS (Problem Resolution Scale) constitue un outil précieux pour évaluer les progrès dans le traitement du TSPT. Comme le décrit cet article sur l’échelle PRS, cette méthode permet de mesurer de manière objective et subjective l’évolution de la personne par rapport à son problème au fil de la thérapie.
Contrairement aux approches diagnostiques traditionnelles qui se concentrent sur les symptômes, l’échelle PRS s’intéresse à la résolution du problème tel qu’il est vécu par la personne. Cette perspective est particulièrement pertinente dans le cas du TSPT, où l’expérience subjective joue un rôle central.
De la mesure à l’intervention
L’utilisation de l’échelle PRS ne se limite pas à l’évaluation des progrès ; elle constitue en elle-même une intervention thérapeutique. En invitant la personne à observer et à quantifier ses progrès, on l’aide à prendre conscience des changements, même minimes, et à renforcer sa perception de contrôle et d’auto-efficacité.
Cette approche s’inscrit parfaitement dans la logique systémique qui considère que la façon dont nous observons et décrivons un problème influence directement notre capacité à le résoudre. En modifiant le regard que la personne porte sur son expérience, on modifie l’expérience elle-même.
Au-delà du trauma : vers une résilience systémique
La résilience comme processus systémique
La résilience, souvent définie comme la capacité à rebondir après un traumatisme, peut être conceptualisée dans une perspective systémique. Comme l’explique cet article sur les cinq cercles de la résilience, la résilience n’est pas une caractéristique individuelle isolée mais un processus qui implique l’interaction de multiples facteurs.
Dans cette perspective, sortir du chaos traumatique ne signifie pas simplement éliminer les symptômes, mais reconstruire un système plus souple et plus adaptatif. Cette reconstruction implique de transformer les patterns relationnels, les croyances et les stratégies d’adaptation.
De la rigidité à la souplesse
Le TSPT se caractérise souvent par une rigidification des perceptions et des comportements. Comme le souligne cet article sur le principe de la pathologie, la rigidité constitue l’essence même de la pathologie dans une perspective systémique.
Le traitement vise donc à restaurer la souplesse du système, à permettre à la personne d’explorer de nouvelles façons de percevoir et de réagir. Cette transformation ne se limite pas à la sphère individuelle mais s’étend à l’ensemble du système relationnel de la personne.
Libérer le corps du poids du passé
Le TSPT s’inscrit profondément dans le corps, à travers les réactions physiologiques d’alarme, les tensions musculaires et les perturbations du sommeil. Libérer le corps du poids du passé constitue donc un aspect essentiel du rétablissement.
L’approche systémique, en particulier lorsqu’elle intègre des éléments d’hypnose et de travail corporel, offre des outils puissants pour aider la personne à retrouver un sentiment de sécurité dans son corps. Cette reconnexion corporelle facilite la réintégration de l’expérience traumatique dans une narration cohérente et supportable.
Conclusion : du chaos à la cohérence
L’approche systémique offre une perspective unique et puissante pour comprendre et traiter le TSPT. En conceptualisant ce trouble comme un système verrouillé par ses propres tentatives de solution, elle ouvre la voie à des interventions ciblées et efficaces.
Sortir du chaos traumatique ne signifie pas effacer le passé, mais transformer la relation que la personne entretient avec son expérience. Cette transformation implique de modifier les patterns cognitifs, émotionnels et relationnels qui maintiennent la souffrance.
L’approche systémique, avec sa vision holistique et son pragmatisme thérapeutique, constitue un cadre particulièrement adapté pour accompagner ce processus. En s’intéressant aux solutions plutôt qu’aux causes, aux patterns plutôt qu’aux contenus, elle permet de naviguer efficacement dans la complexité du traumatisme.
Si vous ou l’un de vos proches souffrez de TSPT, n’hésitez pas à consulter un spécialiste de l’approche systémique. Un accompagnement adapté peut vous aider à transformer le chaos en cohérence et à retrouver un sentiment de contrôle et de sérénité.
Références
Chakroun, M. (2021). A longitudinal study about post-traumatic stress disorder after delivery in Tunisian primiparous.
de Scorraille, C. et al. (2017). Quand le travail fait mal. InterEditions
Vitry, G. (2019). Stratégie du changement. Erès
Vitry, G. et al. (2023).Comprendre et soigner les addictions. Dunod
Vitry, G. et al. (2023). Sortir de l’addiction. Descartes et Cie
Vitry, G. et al. (2024). Le grand livre du diagnostic systémique et de l'intervention stratégique, Dunod.
Vitry, G. (2024). Thérapie brève systémique stratégique. De Boeck