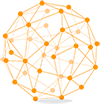Articles les plus consultés
- Parcours formation systémique stratégique en ligne chez LACT
- Témoignage d'un chirurgien sur l'épuisement professionnel
- 5 axiomes de la communication pragmatique (Paul Watzlawick)
- Gestion de conflits en entreprise: Étude de cas d'assurance
- Aidant Familial: Gérer Stress et Émotions au Travail
- Giorgio Nardone : Formation Mastère clinique LACT/CTS en thérapie systémique stratégique
- Les diplômes universitaires (DU) de psychologie à distance
- Évaluation et gestion des RPS en entreprise - Étude de cas
- Bibliographie
- L'approche systémique stratégique de Palo Alto par Wittezaele
Articles et vidéos récents
- Quand l’enfant devient le symptôme du couple parental
- Violence conjugale : briser les chaînes de l’emprise relationnelle
- Hyperphagie boulimique : un symptôme de système ?
- TSPT : comment une approche systémique aide à sortir du chaos
- Dysmorphophobie : quand le miroir devient l’ennemi de l’image de soi
- Doute pathologique : quand la quête de certitude devient toxique
- Procrastination chronique : une stratégie d’évitement ?
- Thérapie systémique face à l’agoraphobie : sortir de la peur du monde
- De la médecine au système : pourquoi le DSM ne suffit plus ?
- L’émotion, langage du vivant et une clinique du lien
- Familles d’aujourd’hui, enjeux systémiques de demain
- Le burn-out : sortir du piège de la suradaptation
- Burnout et dépersonnalisation : quand le travail efface l’individu
- Stress chronique au travail : quand la pression devient pathologique
- RPS au travail : comment détecter et agir efficacement

Dans l’univers complexe des relations familiales, l’enfant occupe souvent une position paradoxale : à la fois sujet de sa propre existence et objet des projections parentales. Lorsque le couple parental traverse des difficultés relationnelles non résolues, un phénomène fascinant mais préoccupant peut émerger : l’enfant devient porteur d’un symptôme qui, tel un messager systémique, révèle les dysfonctionnements du système familial tout entier.

La violence conjugale ne se résume pas à des actes isolés. Elle s’inscrit dans un système relationnel complexe où s’entremêlent emprise psychologique, cycles de violence et tentatives de solutions inefficaces. Dans une lecture systémique, nous sommes face à un véritable piège relationnel où chaque élément - comportements, émotions, croyances - s’auto-alimente dans une spirale destructrice.

L’hyperphagie boulimique se présente comme un trouble alimentaire caractérisé par des épisodes récurrents de consommation excessive de nourriture, accompagnés d’un sentiment de perte de contrôle, mais sans les comportements compensatoires typiques de la boulimie. Pourtant, réduire ce trouble à sa simple expression comportementale serait manquer l’essentiel : sa dimension systémique.

Le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) représente bien plus qu’une simple réaction à un événement traumatique. Il s’agit d’un véritable bouleversement systémique qui affecte l’individu dans sa globalité, perturbant ses relations, son rapport au monde et sa perception de lui-même. Dans une lecture systémique, ce n’est pas tant l’événement traumatique lui-même qui détermine l’apparition du trouble, mais plutôt la manière dont cet événement s’inscrit dans le système de croyances et de relations de la personne.

Le corps, cette enveloppe charnelle qui nous définit aux yeux du monde, devient parfois le théâtre d’une guerre intérieure dévastatrice. La dysmorphophobie, ou trouble dysmorphique corporel (TDC), représente l’une des manifestations les plus troublantes de cette bataille que certains mènent contre leur propre image. Ce trouble anxieux se caractérise par une préoccupation excessive concernant un défaut physique imaginaire ou considérablement exagéré, entraînant une détresse significative et un dysfonctionnement social majeur.

Le doute est cette faculté précieuse qui nous permet de questionner, d’explorer, de ne pas nous enfermer dans des certitudes rigides. Mais que se passe-t-il lorsque ce doute, censé nous libérer, devient lui-même une prison ? Le doute pathologique représente cette perversion d’un mécanisme initialement adaptatif qui, poussé à l’extrême, génère une souffrance considérable.

La procrastination, cette tendance à remettre systématiquement à plus tard ce que l’on pourrait faire maintenant, constitue l’un des comportements humains les plus universels et pourtant des plus mystérieux. Qui n’a jamais repoussé une tâche importante au profit d’activités plus agréables ou moins anxiogènes ? Mais lorsque ce comportement devient chronique, transformant l’exception en règle, nous entrons dans un territoire clinique particulier où l’évitement devient un véritable art de vivre.