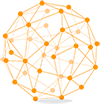Dans cette conférence profonde et incarnée, Gérard Ostermann explore les émotions à travers les neurosciences, l’attachement, la douleur et la relation thérapeutique. Il propose une vision humaniste où l’émotion, loin d’être un trouble, devient langage, signal et moteur du lien. Une ressource essentielle pour les thérapeutes et professionnels de la relation d’aide.
Guide formation
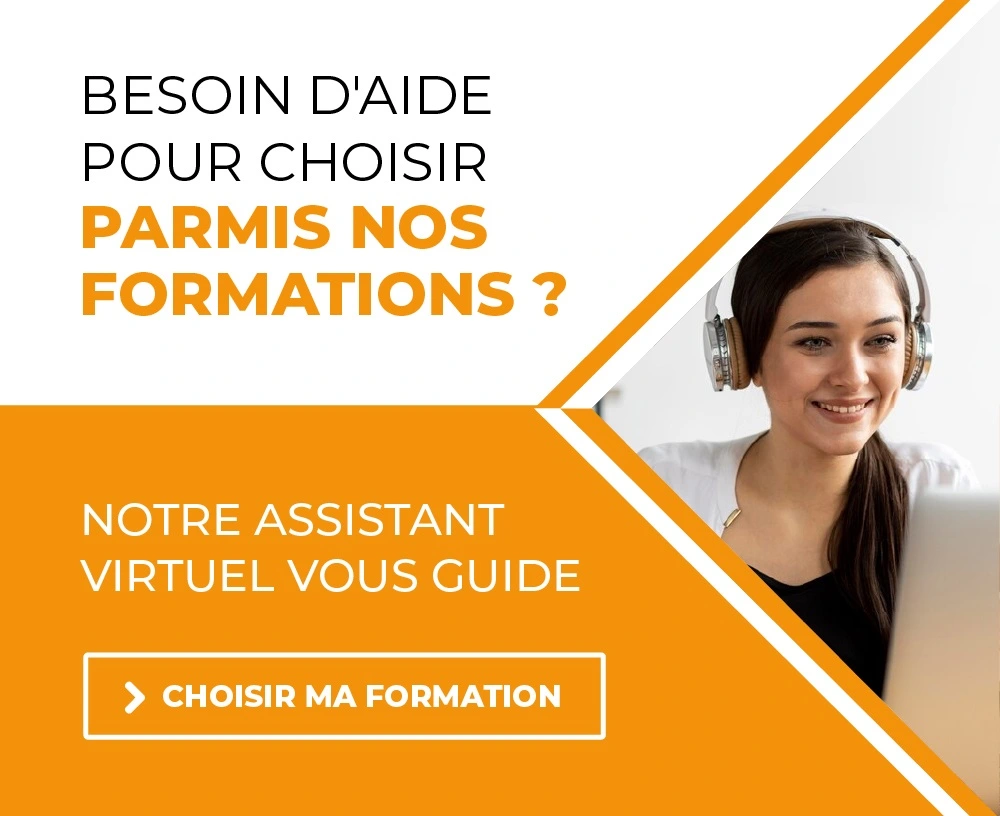

Une clé d'accès à l'humain, l'émotion comme expérience vivante
Dans cette conférence exceptionnelle, Gérard Ostermann explore l’univers des émotions avec une richesse rare. Il décrit les émotions comme des expériences fondamentales, indissociables de notre condition humaine. Il nous parle de leur neurobiologie, leur rôle dans la relation, la thérapie et la survie psychique. Ce voyage traverse la philosophie, la psychanalyse, les neurosciences et la clinique. Loin d’être secondaires, elles sont ce qui nous met en mouvement (du latin ‘emovere’) et nous relie aux autres. En thérapie, elles sont à la fois symptômes, langages et ressources. Les émotions ne sont pas pathologiques en soi. Elles sont souvent les premières à apparaître dans le lien et les dernières à disparaître une fois la transformation psychique opérée.
Émotion, du mouvement à l'affect
Le terme « émotion » n’a pas toujours désigné ce qu’il recouvre aujourd’hui. Le mot ‘émotion’ vient de l’ancien français ‘es-mouvoir’ – se mouvoir vers l’extérieur. Au Moyen-Âge, on parlait de « es-mouvoir » pour évoquer un trouble physique, sans lien avec la vie psychique. Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que le mot prend une connotation intérieure. Ce glissement linguistique est crucial pour comprendre l’évolution du regard porté sur l’émotion : d’un événement corporel visible (tremblement, fuite, agitation) à une expérience intime, subjective, souvent invisible, qui nous invite à penser l’émotion comme un phénomène hybride : entre corps et psyché, entre action et conscience. Ce passage historique éclaire nos difficultés contemporaines à accueillir les émotions : elles sont à la fois trop visibles (cris, larmes) et trop silencieuses (angoisse contenue).
Le cerveau bayésien et les racines relationnelles de l’émotion
S’appuyant sur la neurobiologie moderne, sur les travaux de Hugo Bottemanne, Gérard Ostermann évoque la théorie du cerveau bayésien : notre cerveau fonctionne par prédiction, établissant des modèles et des hypothèses sur le monde, les confronte à l’expérience et ajuste ses croyances. L’émotion surgit lorsqu’il y a un écart entre le modèle interne et la réalité extérieure. Elle est, à ce titre, un signal d’alerte, une perturbation utile. Par exemple, la peur naît quand un danger imprévu surgit, alors que l'on se croyait en sécurité. Ce modèle intègre les biais attentionnels, les distorsions perceptives,et la mémoire affective. Il montre que l’émotion n’est jamais une simple réaction chimique : elle est ancrée dans un réseau de croyances, de contextes,et de récits.
La relation mère-enfant, regard, microchimérisme et cerveau social
L’attachement mère-enfant, loin d’être purement psychologique, s’enracine dans une biologie du lien. Le microchimérisme fœtal – la présence de cellules du fœtus dans le corps maternel, y compris dans le cerveau – illustre cette intrication. Des études montrent que ces cellules peuvent moduler des comportements de soin, de vigilance, voire de protection maternelle. Le regard joue aussi un rôle fondamental dans les premières heures de vie. Les travaux de Pierre Rousseau montrent qu’un regard mutuel entre la mère et le bébé, dans les premières 4 minutes, entraîne une chute rapide du cortisol (hormone du stress). Le lien précède donc la parole, la pensée, et même la mémoire. Il est corporel, direct, archaïque, mais fondateur.
Attachement, perception, prédiction, vers une clinique de l'accordage
Gérard Ostermann propose une lecture fine de l’attachement en tant que système de régulation émotionnelle. L’enfant construit ses représentations de soi et du monde à travers le regard de l’autre, dans une forme d’écho affectif. Être ‘en lien’ ne signifie pas simplement être présent physiquement, mais être en résonance émotionnelle avec ce que l’autre vit. En thérapie, cela suppose une posture d’écoute incarnée, de présence ajustée, qui favorise un accordage émotionnel profond. L’accordage permet la co-régulation : un patient qui pleure dans un espace sécurisé apprend peu à peu à contenir, symboliser et penser ses émotions.
L’émotion n’est pas un défaut, valence, intensité et survie psychique
Chaque émotion a une fonction. La tristesse signale une perte, la peur un danger, la colère une injustice. Elles sont des indicateurs. G.Ostermann insiste : l’important n’est pas de les classer en ‘positives’ ou ‘négatives’, mais de reconnaître leur utilité. Certaines émotions faibles mais persistantes (ex. anxiété de fond) peuvent épuiser le système psychique. D’autres, très intenses, peuvent nous submerger ou provoquer un figement. L’objectif thérapeutique est d’aider à moduler l’intensité, à nommer ce qui est ressenti, à en faire quelque chose de pensable. C’est une question de survie psychique autant que de relation à soi.

Réservez une consultation en cabinet à Paris Montorgueuil ou à distance en visio-conférence
Nous recevons nos patients du lundi au vendredi.
Pour prendre un rdv vous pouvez nous appeler au +33 (0) 1 48 07 40 40
ou au +33 (0) 6 03 24 81 65 ou bien encore le fixer directement en ligne
en cliquant ici :
De la douleur à la pensée, émotions et maladies psychosomatiques
Le corps exprime parfois ce que la parole ne peut dire. G. Ostermann revient sur son travail clinique autour de la douleur des patients atteints d’affections chroniques ou de troubles somatoformes. Il montre comment l’alexithymie – l’incapacité à identifier et verbaliser les émotions – empêche la régulation émotionnelle et favorise l’expression corporelle du mal-être. Dans ces cas, la douleur est réelle, mais elle devient aussi le seul langage possible pour dire la détresse. L’intervention thérapeutique vise alors à restaurer un espace symbolique où la douleur puisse être mentalisée,et où le patient puisse se réapproprier son expérience émotionnelle.
Quelles émotions primaires ? Universalité, culture et modèles
Les modèles classiques des émotions primaires (Ekman et Plutchik) listent des affects universels : peur, colère, tristesse, joie, surprise, dégoût. Mais Gérard Ostermann souligne que leur expression et leur sens sont modulés par la culture. L’exemple de l’‘amae’ japonais – dépendance affective gratifiante – montre qu’il existe des nuances émotionnelles intraduisibles d’une langue à l’autre. Il invite donc à dépasser les catégories figées et à considérer les émotions comme des constructions
à la fois biologiques, relationnelles et culturelles. Une émotion ne se comprend que dans son contexte d’émergence.
Régulation, vers une intelligence émotionnelle incarnée
Le mot ‘gestion’ des émotions trahit une conception techniciste : on gère des comptes, pas des affects. Gérard Ostermann préfère le terme de régulation émotionnelle, qui suppose un mouvement intérieur de mise en lien, d’ajustement, de transformation. Il évoque l’idée que certaines émotions ne sont pas ‘à nous’ : elles sont transmises par nos parents, notre histoire, notre culture. Une thérapie émotionnelle suppose donc un travail d’appropriation, de discernement, parfois de désidentification. Il s’agit de retrouver sa propre voix émotionnelle et non de performer une norme.
Le double accordage
Le double accordage est pour Gérard Ostermann la clé du soin : le thérapeute doit s’accorder au patient mais aussi aider le patient à s’accorder à lui-même. Cela suppose un engagement affectif subtil, une présence ouverte, une capacité à être touché sans être envahi. Ce n’est pas une fusion, mais une résonance. Le thérapeute devient alors un co-régulateur temporaire, un tuteur de résilience émotionnelle. La conclusion poétique de Gérard Ostermann, par une citation de François Cheng, réaffirme l’ancrage humaniste de sa pensée : ‘Tant qu’il y aura un visage qui nous émeut, une main qui esquisse un geste de tendresse, alors nous nous attarderons sur cette Terre.’
Conclusion
Cet article approfondi rend hommage à la pensée incarnée de Gérard Ostermann sur les émotions. Il offre aux thérapeutes, soignants et étudiants une boussole précieuse pour comprendre l’émotion comme langage du vivant, enjeu de soin, et force de transformation.
Où se former à l’approche systémique et stratégique?
LACT propose plusieurs parcours de formation web certifiantes en direct avec 50 formateurs internationaux
- Formation systémique généraliste
- DU clinique de la relation avec l‘université de Paris 8
- Mastere clinique avec spécialisation en psychopathologie avec le CTS du Pr Nardone