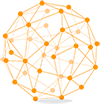Le corps, cette enveloppe charnelle qui nous définit aux yeux du monde, devient parfois le théâtre d’une guerre intérieure dévastatrice. La dysmorphophobie, ou trouble dysmorphique corporel (TDC), représente l’une des manifestations les plus troublantes de cette bataille que certains mènent contre leur propre image. Ce trouble anxieux se caractérise par une préoccupation excessive concernant un défaut physique imaginaire ou considérablement exagéré, entraînant une détresse significative et un dysfonctionnement social majeur.
Touchant environ 1 à 2% de la population générale et plus de 10% des patients en psychiatrie adulte (Siegfried et al., 2017), la dysmorphophobie reste pourtant méconnue, souvent confondue avec d’autres troubles comme l’hypocondrie, les TOC ou les troubles alimentaires. Cette préoccupation obsessionnelle pour un défaut corporel perçu transforme le miroir en ennemi, le regard des autres en menace, et l’existence en une quête désespérée de perfection inatteignable.
Dans une perspective systémique, ce trouble ne peut être réduit à une simple distorsion perceptive individuelle. Il s’inscrit dans un système complexe d’interactions entre la personne, son histoire, son environnement social et culturel, et les tentatives de solutions qu’elle a mises en place pour gérer sa souffrance. Ces tentatives, paradoxalement, finissent souvent par maintenir et amplifier le problème qu’elles cherchaient à résoudre.
Le corps sous haute surveillance : mécanismes et manifestations
La prison du miroir

La dysmorphophobie se manifeste par une focalisation excessive sur une partie du corps perçue comme défectueuse. Cette préoccupation devient envahissante, occupant plusieurs heures par jour dans les cas sévères. Comme le souligne Vitry (2024) dans “La thérapie brève systémique stratégique”, ce trouble s’accompagne de comportements ritualisés visant à vérifier, dissimuler ou corriger le défaut perçu : vérifications répétées dans le miroir ou toute surface réfléchissante, comparaisons avec d’autres personnes, recherche constante de réassurance, camouflage excessif, et parfois recours à des interventions médicales ou chirurgicales multiples.
Ces comportements, loin d’apaiser l’anxiété, l’alimentent dans un cercle vicieux implacable. Chaque vérification dans le miroir devient une nouvelle occasion de confirmer la présence du défaut, chaque tentative de camouflage renforce l’idée qu’il existe quelque chose à cacher, chaque recherche de réassurance valide l’importance accordée à ce défaut supposé.
L’illusion tenace et ses conséquences
La particularité troublante de la dysmorphophobie réside dans la conviction inébranlable du patient quant à la réalité et l’importance de son défaut, alors même que celui-ci est invisible aux yeux des autres ou objectivement minime. Cette auto-illusion s’apparente à ce que Watzlawick décrivait comme une prophétie autoréalisatrice : à force de se percevoir comme défiguré ou disgracieux, la personne adopte des comportements d’évitement social qui finissent par créer un réel isolement.
Les conséquences sont souvent dévastatrices : isolement social, dépression, anxiété, idées suicidaires, abandon des études ou de l’emploi. Une étude récente montre que l’usage fréquent des réseaux sociaux est associé à une image corporelle négative chez les adolescents, filles comme garçons (Revranche et al., 2021), exacerbant potentiellement les symptômes dysmorphophobiques dans cette population vulnérable.
La dysmorphophobie dans le prisme systémique
Au-delà du symptôme individuel
L’approche systémique stratégique nous invite à considérer la dysmorphophobie non pas comme un simple trouble perceptif individuel, mais comme le symptôme d’un système plus large en dysfonctionnement. Comme l’explique de Scorraille (2017) dans “Quand le travail fait mal”, tout symptôme psychologique remplit une fonction dans le système où il apparaît, et la dysmorphophobie ne fait pas exception.
Cette préoccupation excessive pour un défaut corporel peut ainsi servir de “tentative de solution” face à d’autres difficultés : anxiété sociale, problèmes identitaires, traumatismes, conflits familiaux non résolus. En focalisant toute son attention sur ce défaut supposé, la personne évite inconsciemment de confronter ces problèmes plus profonds, dans une forme de doute pathologique concernant sa valeur et son acceptabilité sociale.
Le paradoxe des tentatives de solutions
“Pour sortir de la douleur, il faut la traverser” - cette maxime, citée par Vitry (2024), illustre parfaitement le paradoxe thérapeutique face à la dysmorphophobie. Les tentatives habituelles pour soulager l’anxiété liée au défaut perçu (vérifications, camouflage, réassurance) constituent en réalité le carburant qui alimente le trouble.
Ce mécanisme s’apparente à ce que Watzlawick nommait “plus de la même chose” : appliquer avec plus d’intensité une solution qui ne fonctionne pas, espérant qu’elle finira par fonctionner. Ainsi, plus la personne vérifie son apparence dans le miroir pour se rassurer, plus elle renforce sa conviction qu’il y a quelque chose à vérifier. Plus elle cherche à camoufler son “défaut”, plus elle valide l’idée qu’il est visible et inacceptable.
La thérapie brève stratégique vise précisément à interrompre ce cercle vicieux en proposant des interventions paradoxales qui bousculent ces patterns dysfonctionnels.
Stratégies thérapeutiques : réconcilier la personne avec son reflet
Déconstruire l’illusion
La première étape thérapeutique consiste à reconnaître la souffrance réelle du patient tout en travaillant à déconstruire progressivement sa conviction concernant son défaut. Contrairement aux approches confrontatives qui tentent de convaincre directement le patient que son défaut n’existe pas (ce qui renforce généralement sa résistance), l’approche stratégique utilise des voies indirectes.
La technique “imaginer le pire”, décrite par Vitry (2024), invite le patient à explorer en détail le scénario catastrophe qu’il redoute : “Que se passerait-il si les autres remarquaient votre défaut ? Et ensuite ? Et après ?” Cette exploration progressive permet de dédramatiser les conséquences anticipées et de relativiser l’importance accordée au défaut perçu.
Interrompre les comportements de vérification
Les comportements de vérification et de réassurance constituent le cœur du problème. La prescription du symptôme, technique paradoxale par excellence, peut s’avérer particulièrement efficace : plutôt que de lutter contre ces comportements, le thérapeute les prescrit de manière ritualisée et contrôlée.
Par exemple, le patient peut être invité à se regarder dans le miroir à des moments précis de la journée, pendant une durée déterminée, en notant précisément ses observations et ses émotions. Cette ritualisation permet de transformer un comportement compulsif en une démarche d’observation plus distanciée et contrôlée.
Réorienter l’attention
La technique de “l’échelle”, mentionnée par Vitry (2024) comme outil d’évaluation des progrès thérapeutiques, peut être adaptée pour aider le patient à élargir progressivement son champ attentionnel au-delà de son défaut perçu. En évaluant régulièrement l’intensité de sa préoccupation sur une échelle de 0 à 10, le patient prend conscience des fluctuations de son trouble et des facteurs qui l’influencent.
Cette prise de conscience ouvre la voie à l’introduction d’activités alternatives qui détournent progressivement l’attention du corps vers d’autres centres d’intérêt. L’hypnose ericksonienne, avec ses techniques de focalisation et de dissociation, peut constituer un complément thérapeutique précieux pour faciliter ce réinvestissement attentionnel.
Reconstruire l’image corporelle
Au-delà de la réduction des symptômes, la thérapie vise à reconstruire une image corporelle plus positive et intégrée. Une étude récente (Mattatia et al., 2023) suggère que des approches combinant travail psychologique et corporel peuvent réduire significativement les préoccupations corporelles chez les patients souffrant de troubles de l’image du corps.
Dans cette perspective, la thérapie systémique peut s’enrichir d’approches complémentaires comme la psychomotricité ou certaines pratiques de pleine conscience centrées sur le corps, non pour “corriger” le défaut perçu, mais pour développer une relation plus apaisée et fonctionnelle avec son corps dans sa globalité.

Le rôle de l’environnement social
La famille comme système
La dysmorphophobie ne se développe pas en vase clos. L’environnement familial joue souvent un rôle déterminant dans son apparition et son maintien. Des messages explicites ou implicites sur l’importance de l’apparence, des critiques répétées sur le physique, ou à l’inverse, une surprotection qui empêche l’enfant de développer une image corporelle autonome, peuvent constituer un terreau fertile pour ce trouble.
La thérapie familiale systémique peut alors s’avérer précieuse pour identifier et modifier ces patterns relationnels dysfonctionnels. Comme le souligne Robert Neuburger dans ses travaux sur les mythes familiaux, chaque famille développe ses propres croyances sur ce qui définit la valeur d’un individu - l’apparence physique pouvant occuper une place disproportionnée dans certains systèmes familiaux.
Culture et normes esthétiques
Notre époque, avec son culte de la perfection physique véhiculé par les médias et les réseaux sociaux, constitue un environnement particulièrement propice au développement des troubles de l’image corporelle. La dysmorphophobie peut ainsi être comprise comme une forme extrême d’intériorisation de normes esthétiques irréalistes.
La thérapie ne peut ignorer cette dimension culturelle. Elle doit aider le patient à développer un regard critique sur ces normes et à construire ses propres critères de valeur au-delà de l’apparence physique. Cette démarche rejoint ce que Vitry (2024) décrit comme le “paradoxe de la victoire épuisante” : la quête obsessionnelle de perfection physique, même si elle était atteignable, ne conduirait pas au bonheur espéré.
Conclusion : au-delà du miroir
La dysmorphophobie représente bien plus qu’une simple préoccupation excessive pour un défaut physique. Elle révèle une souffrance profonde liée à l’image de soi, à l’identité et à la place que l’on occupe dans le regard des autres. L’approche systémique stratégique offre des outils précieux pour comprendre et traiter ce trouble complexe, en considérant non seulement les symptômes individuels, mais aussi le système relationnel et culturel dans lequel ils s’inscrivent.
En dépassant la simple correction des distorsions perceptives pour s’intéresser aux fonctions que remplit le symptôme dans l’économie psychique du patient et dans son système relationnel, cette approche permet d’envisager une guérison plus profonde et durable. Car l’enjeu n’est pas seulement d’apprendre à voir son corps différemment, mais de reconstruire une relation plus apaisée avec soi-même et avec les autres.
Si vous ou l’un de vos proches souffrez de préoccupations excessives concernant votre apparence physique, n’hésitez pas à consulter nos spécialistes formés à l’approche systémique stratégique. Un accompagnement adapté peut vous aider à vous libérer de cette prison du miroir et à redécouvrir la richesse d’une vie qui ne se limite pas à l’apparence.
Références
de Scorraille, C. et al. (2017). Quand le travail fait mal. InterEditions.
Mattatia, J., et al. (2023). Anorexie mentale et médiations somatiques : évaluations croisées de l’ostéopathie et de la psychomotricité sur les préoccupations corporelles. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Volume 181, Issue 9, p. 802-809.
Revranche, M., et al. (2021). Lien entre usage des réseaux sociaux et image corporelle chez les adolescents : une revue systématique de la littérature, Encephale.
Siegfried E, Ayrolles A, Rahioui H. (2017).Body dysmorphic disorder: Future prospects of medical care. Encephale.
Vitry, G. (2024). La thérapie brève systémique stratégique. De Boeck Supérieur.
Vitry, G. (2024). Le grand livre du diagnostic systémique et de l’intervention stratégique. Dunod.