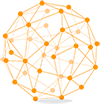Dans l’univers de la santé mentale, le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM) représente depuis des décennies la référence absolue. Cette “bible psychiatrique” comme certains aiment à l’appeler, offre aux praticiens un langage commun, une taxonomie des troubles mentaux qui a permis d’uniformiser les diagnostics et de faciliter la recherche. Loin d’une lecture nosographique, l’approche systémique propose un regard différent sur les troubles psychiques, considérant l’individu non comme porteur d’une pathologie isolée, mais comme élément d’un système dont les interactions déterminent le fonctionnement et les dysfonctionnements.
Introduction : les limites d’une classification médicale face à la complexité humaine
Le DSM, malgré ses révisions successives, reste ancré dans une vision médicale nosographique où le symptôme est roi. L’approche systémique, elle, s’intéresse aux relations, aux contextes, aux tentatives de solution qui maintiennent le problème. Ce changement de paradigme transforme profondément la compréhension et le traitement des troubles mentaux.
La tyrannie de l’étiquette : quand le diagnostic devient identité
Le DSM a indéniablement apporté une rigueur dans le champ psychiatrique. Cependant, sa tendance à la catégorisation rigide a créé ce que certains appellent la “tyrannie de l’étiquette”. Une fois diagnostiqué, le patient risque de se voir réduit à son trouble, d’intégrer cette étiquette comme élément constitutif de son identité.
Comme le souligne Di Vittorio et ses collègues (2013), les virages successifs du DSM reflètent des enjeux non seulement scientifiques mais aussi économiques et politiques. La médicalisation croissante de l’existence humaine transforme des difficultés existentielles en pathologies traitables par voie médicamenteuse.
L’approche systémique propose une vision complémentaire : elle s’intéresse moins à ce qu’est la personne (sa “pathologie”) qu’à ce qu’elle fait (ses comportements, ses interactions). Comme l’explique Watzlawick dans ses travaux fondateurs sur la communication pragmatique, ce sont les patterns interactionnels qui maintiennent les problèmes, non les caractéristiques intrinsèques des individus.

Le problème de la comorbidité : quand les étiquettes s’accumulent
Un des écueils majeurs du DSM réside dans le phénomène de comorbidité. Selon Regier et al. (2009), la forte comorbidité entre troubles et l’absence de séparation claire entre eux remettent sérieusement en cause la validité du manuel. En pratique, il n’est pas rare qu’un patient cumule plusieurs diagnostics, sans que cela n’éclaire véritablement sa situation ni n’oriente efficacement le traitement.
L’approche systémique offre une lecture différente : plutôt que d’additionner les diagnostics, elle cherche à comprendre comment les symptômes s’articulent dans une logique systémique. Un doute pathologique n’est pas simplement un trouble anxieux à étiqueter, mais s’inscrit dans un système de pensée et d’interaction avec l’environnement.
Selon Vitry, “les symptômes ne sont pas des entités isolées mais des éléments interconnectés dans un système de fonctionnement global de la personne”. Cette vision holistique permet de dépasser la fragmentation diagnostique pour saisir la cohérence interne des difficultés présentées.
L’illusion de l’objectivité : le DSM face aux données empiriques
Le DSM se présente comme un outil objectif, basé sur des critères observables et mesurables. Pourtant, comme le souligne Andreasen (2006), son développement a conduit à un déclin de l’évaluation clinique individualisée au profit de critères standardisés. Cette standardisation excessive pose problème face à la complexité des situations cliniques. Les catégories du DSM, supposées distinctes, présentent en réalité des frontières floues. Wakefield (2016) a mis en évidence les problèmes persistants de faux positifs, particulièrement préoccupants dans le DSM-5 qui a élargi plusieurs critères diagnostiques.
L’approche systémique, sans rejeter l’importance d’une évaluation rigoureuse, propose des outils d’analyse contextuels. La Problem Resolution Scale (PRS), développée dans ce cadre, permet d’évaluer les progrès thérapeutiques non en fonction de la disparition des symptômes, mais de l’amélioration du fonctionnement global de la personne dans son environnement. Cette échelle mesure l’évolution de la résolution du problème, avec des indicateurs précis qui permettent d’objectiver les changements tout en respectant la singularité de chaque situation.
Au-delà du symptôme : la logique du système
Le DSM se concentre sur les symptômes comme manifestations d’un trouble sous-jacent. L’approche systémique renverse cette perspective : les symptômes ne sont pas tant les signes d’une pathologie que les éléments d’un système qui s’auto-entretient. Prenons l’exemple des TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs). Dans la perspective du DSM, ils sont définis par la présence d’obsessions et de compulsions répondant à des critères spécifiques. L’approche systémique, elle, s’intéresse à la fonction de ces comportements dans l’économie psychique de la personne et dans ses relations.
Comme l’explique Nardone dans ses travaux sur les “pièges psychologiques” (2013), les TOC répondent à une logique paradoxale : les tentatives de solution (les rituels) deviennent le problème. Cette compréhension ouvre des perspectives thérapeutiques novatrices, axées non sur l’élimination des symptômes mais sur la modification des tentatives de solution dysfonctionnelles. Cette approche s’avère particulièrement pertinente pour les TOC avec rituels où les comportements compulsifs sont maintenus par leur fonction anxiolytique à court terme, malgré leurs conséquences invalidantes à long terme.
Le contexte oublié : culture, environnement et relations
Une des critiques majeures adressées au DSM concerne son insuffisante prise en compte des facteurs contextuels. Malgré des efforts pour intégrer des considérations culturelles dans ses dernières versions, le manuel reste fondamentalement ancré dans une conception occidentale de la normalité et de la pathologie. Selon Devgun (2023), le DSM présente une applicabilité culturelle limitée, même après des tentatives d’intégration d’éléments culturels. Cette limitation peut conduire à des erreurs diagnostiques et à des interventions thérapeutiques inadaptées.
L’approche systémique, par son attention aux contextes et aux relations, permet d’appréhender la diversité des expressions de la souffrance psychique selon les cultures. Elle s’intéresse aux normes familiales, sociales et culturelles qui définissent ce qui est considéré comme problématique dans un contexte donné. Cette sensibilité contextuelle se révèle particulièrement précieuse dans des situations comme le harcèlement scolaire ou le harcèlement moral en entreprise, où les dynamiques relationnelles et institutionnelles jouent un rôle déterminant.
La révolution épistémologique : du linéaire au circulaire
Au-delà des critiques spécifiques, c’est toute l’épistémologie sous-jacente au DSM qui est remise en question par l’approche systémique. Le manuel repose sur une causalité linéaire (un trouble cause des symptômes) tandis que l’approche systémique s’appuie sur une causalité circulaire (les symptômes et leurs “solutions” s’entretiennent mutuellement). Ce changement de paradigmei transforme radicalement notre compréhension des phénomènes observés.
La théorie de la double contrainte développée par Bateson illustre parfaitement cette circularité : dans certaines configurations relationnelles, l’individu se trouve pris dans des injonctions contradictoires qui créent une impasse dont la “folie” peut constituer la seule échappatoire logique.
Des catégories aux processus : vers une clinique du changement
Le DSM propose une classification statique des troubles mentaux. L’approche systémique s’intéresse davantage aux processus dynamiques qui maintiennent les difficultés ou permettent le changement. Cette orientation vers le changement plutôt que vers la classification se traduit par des interventions thérapeutiques spécifiques. Le dialogue stratégique développé par Nardone constitue un exemple emblématique de cette approche : plutôt que de chercher à comprendre pourquoi le problème existe (orientation DSM), il vise à découvrir comment il fonctionne et se maintient pour introduire des changements stratégiques. Cette méthode s’est révélée particulièrement efficace dans le traitement de troubles variés, des phobies aux troubles alimentaires, en passant par les troubles anxieux.
L’intégration des approches : vers un modèle biopsychosocial systémique
Critiquer le DSM ne signifie pas le rejeter entièrement. L’enjeu actuel réside plutôt dans l’intégration des perspectives médicales et systémiques au sein d’un modèle véritablement biopsychosocial.
Engel (1980) avait déjà proposé ce modèle comme alternative à l’approche purement biomédicale. L’approche systémique permet d’enrichir cette perspective en apportant une compréhension fine des dynamiques relationnelles et des processus de changement. Cette intégration s’avère particulièrement féconde dans des domaines comme l’addictologie. Dans son ouvrage “Comprendre et soigner les addictions”, Vitry et al. (2023) proposent une lecture des dépendances qui articule les dimensions biologiques, psychologiques et sociales dans une perspective systémique.
Conclusion : pour une clinique de la complexité
Le DSM a indéniablement contribué à structurer le champ de la santé mentale en proposant un langage commun. Cependant, ses limites apparaissent de plus en plus clairement à mesure que notre compréhension de la complexité humaine s’affine.
L’approche systémique, sans prétendre détenir toutes les réponses, offre un cadre conceptuel et méthodologique particulièrement adapté à cette complexité. Elle nous invite à dépasser les catégories figées pour appréhender les processus dynamiques, à considérer les symptômes dans leur contexte relationnel, à privilégier le changement sur la classification.
Cette perspective transforme profondément la pratique clinique, ouvrant la voie à des interventions plus souples, plus contextualisées et, in fine, plus efficaces. Car l’enjeu n’est pas tant de nommer correctement les troubles que d’aider concrètement les personnes à sortir des impasses dans lesquelles elles se trouvent.
Pour approfondir cette approche novatrice et peut-être expérimenter ses bénéfices, les consultations proposées par LACT offrent un espace où la complexité de votre situation sera accueillie et abordée dans toutes ses dimensions, au-delà des étiquettes diagnostiques.
Références
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 (5th ed.). Washington: American Psychiatric Publishing.
Andreasen, N. (2006). DSM and the death of phenomenology in America: an example of unintended consequences. Schizophrenia Bulletin, 32(1), 104-112.
Devgun, A. (2023). Cultural Competence in Mental Health Diagnosis: The DSM and its Global Applicability. Journal of Cross-Cultural Psychology.
Di Vittorio, P., Minard, M., & Gonon, F. (2013). Les virages du DSM: enjeux scientifiques, économiques et politiques. Hermès, La Revue, 66, 85-92.
Engel, G. L. (1980). The clinical application of the biopsychosocial model. American Journal of Psychiatry, 137, 535-544.
Nardone, G. (2013). Psicotrappole, ovvero le sofferenze che ci costruiamo da soli: imparare a riconoscerle e a combatterle. Milano: Ponte alle Grazie.
Regier, D. et al. (2009). The conceptual development of DSM-V. American Journal of Psychiatry, 166(6), 645-650.
Wakefield, J. (2016). Diagnostic Issues and Controversies in DSM-5: Return of the False Positives Problem. Annual Review of Clinical Psychology, 12, 105-132.
Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1974). Changements. Paradoxes et psychothérapie. Paris: Seuil.